mardi, 02 décembre 2014
218. Un lieu, un livre -3-
La belle ville de camaïeu rose (Jaïpur)

Avoir une grande ville rose, entièrement rose, du même rose et semée des mêmes bouquets blancs, ses maisons, ses remparts, ses palais, ses temples, ses tours et ses miradors, quel étonnant caprice de souverain ! On dirait qu’on a tendu tous les murs d’une même vieille indienne à fleurs, on dirait une ville en vieux camaïeu du XVIIIe siècle ; cela diffère de tout ce qu’on avait vu ailleurs, cela arrive à des effets de complète et charmante invraisemblance. [ … ]
Au milieu de la chaussée, le défilé est continuel, de cavaliers aux armes d’argent sur des selles éclatantes, de lourds chariots traînés par des zébus aux cornes peintes, de chameaux attachés en longue file, d’éléphants en robe dorée dont on a barbouillé la trompe de mille dessins. Passent aussi des dromadaires, que montent deux personnages l’un derrière l’autre, et qui vont au trot léger, le cou rendu, comme des autruches à la course ; passent des fakirs entièrement nus, poudrés à blanc de la tête aux pieds ; passent des palanquins et des chaises à porteurs : tout l’Orient des féeries, processionnant à grand spectacle, dans l’inimaginable cadre de camaïeu rose. [ … ]

Mais il y a aussi des rôdeurs bien lugubres — des échappés de sarcophage, dans le genre des êtres qui gisent là-bas aux portes des remparts… Ils ont osé entrer dans la belle ville couleur de fleur, ceux-là, et y traîner leurs ossements ! … Il y en a même beaucoup plus qu’on eût dit au premier abord. Ceux qui errent, chancelants et les yeux hagards, ne sont pas seuls ici : sur les pavés, parmi les marchands, parmi les gais étalages, se dissimulent d’horribles paquets de haillons et de squelettes qui obligent les passants à se détourner pour ne pas marcher dessus …
Et ces fantômes-là, ce sont les paysans des plaines d’alentour. Depuis qu’il ne pleut plus, ils ont lutté contre la destruction du sol, et les longues souffrances les ont préparés à ces maigreurs sans nom. À présent, c’est fini. Le bétail est mort, parce qu’il n’y avait plus d’herbe, et on en a vendu la peau à vil prix. Quant aux champs qu’on ensemençait, ce ne sont plus que des steppes de terre émiettée et brûlée, où rien ne saurait germer. On a vendu aussi, pour acheter de quoi manger, les hardes qu’on avait pour se couvrir, les anneaux d’argent qu’on avait aux bras et aux pieds. On a maigri pendant des mois. Et puis la faim est venue tout de bon, la faim torturante, et bientôt les villages se sont remplis de l’odeur des cadavres.
Manger ! Ils voulaient manger, ces gens, voilà pourquoi ils étaient venus vers la ville. Il leur semblait qu’on aurait pitié, qu’on ne les laisserait pas mourir, car ils avaient entendu dire qu’on amassait ici des grains et des farines comme pour un siège, et que tout le monde mangeait dans ces murs. [ … ]
En ce moment, il s’agit de décharger sur un trottoir, devant des greniers sans doute trop remplis, une centaine de sacs de grains que des chameaux apportent, et il faut pour cela déranger trois petits enfants-squelettes, de cinq à dix ans, tout nus, qui reposaient ensemble à la place choisie.
« Ce sont trois frères, explique une voisine ; les parents qui les avaient amenés sont morts (de faim, c’est sous-entendu) ; alors ils sont là, ils restent là, ils n’ont plus personne. »
Et elle paraît le trouver tout naturel, cette créature, qui pourtant n’a pas l’air d’une méchante femme ! … Mon Dieu, qu’est-ce donc que ce peuple ? Et comment sont faites les âmes de ces gens, qui pour rien au monde ne tuerait un oiseau, mais qui ne se révoltent pas de ce qu’on laisse, devant leur porte, mourir les petits-enfants ?
Au croisement de deux avenues de palais et de temples roses, sur une de ces places qu’encombrent les marchands, les cavaliers, les femmes drapées de mousselines et couvertes d’anneaux d’or, un étranger, un Français, vient d’arrêter sa voiture, près d’un tas sinistre de décharnés qui ne bougent plus, et il s’est baissé pour mettre des pièces de monnaie dans leurs mains inertes.


Alors, soudainement, c’est comme la résurrection de toute une tribu de momies ; les têtes se dressent de dessous les haillons qui couvraient les figures ; les yeux regardent, puis les formes squelettales se remettent debout : « Quoi ! On fait l’aumône ! Il y a quelqu’un qui donne ! On va pouvoir acheter à manger. » Le macabre réveil se propage en traînée subite jusqu’à d’autres tas qui gisaient plus loin, dissimulés derrière des promeneurs, derrière des piles d’étoffes ou des fourneaux de pâtissier. Et tout cela grouille, surgit et s’avance : masques de cadavres dont les lèvres recroquevillées laissent trop voir les dents, yeux caves aux paupières mangées par les mouches, mamelles qui pendent comme des sacs vides sur les cercles du thorax, ossatures qui se heurtent avec des bruits de morceaux de bois. Et l’étranger, en une minute, est entouré d’une ronde de cimetières, pressé, griffé par des mains déjà terreuses, aux grands ongles, qui cherchent à lui arracher son argent, tandis que les pauvres yeux, au contraire, demandent pardon, remercient et supplient …
Et puis, silencieusement, cela s’effondre. Un des spectres, qui chancelait de faiblesse, s’est accroché au spectre voisin, qui a chancelé à son tour, et la chute s’est communiquée de proche en proche, sans un cri, sans une résistance, tous les épuisés de cramponnant les uns aux autres et tombant ensemble, comme de lamentables marionnettes, comme s’abattent des quilles, puis roulant dans la poussière, évanouis, ne se relevant plus … [ … ]
Pour ceux-là qui sont par terre, qu’importe le jour bruyant, ou la nuit tranquille, ou le radieux matin, puisqu’il n’y a plus d’espérance, puisque personne n’aura pitié, puisqu’il faut rester où la tête alourdie est tombée, et attendre là, sur le même pavé, la grande crispation qui finira tout …
Extrait de : L’Inde (sans les Anglais) 1899-1900, Pierre Loti.
Mars 2014 :
Notre car vient juste de s’arrêter le long du trottoir et déjà c’est l’assaut ! Je laisse les autres descendre et affronter cette masse informe d’estropiés, de mutilés, de jeunes femmes tenant dans leurs bras des petites crevettes rougies par les rayons brûlants du soleil –des nouveaux nés aux visages de petits vieux-.
L’air est presque irrespirable tant la chaleur est intense, les bruits de la ville nous assourdissent et l’agitation est totalement frénétique. Ça grouille de partout à en donner le vertige ! Durant plus de trois heures, nous allons arpenter ainsi les rues de la ville rose, nous mêler à cette foule colorée, humer des odeurs de fritures qui se mélangent avec celles des égouts bouchés. Si, par malheur, on s’arrête devant une échoppe pour observer un bibelot, aussitôt le marchand apparait et on ne peut plus s’en débarrasser. Il vous suit sans répit, revenant à la charge pour essayer de vendre sa marchandise malgré votre refus. Alors il faut se fâcher, élever la voix pour qu’enfin il fasse demi-tour… Mais on le retrouve bientôt quelques minutes plus tard, revenant à la charge. C’est insupportable !
Quand enfin on rejoint le car, on retrouve alors toute la horde des estropiés qui reprennent leur harcèlement pour obtenir quelques pièces. Ils se bousculent, s’engueulent entre eux et vous tirent par les vêtements. Que faire ? Si vous donnez quelque chose à l’un, les autres vont se ruer sur lui et vont devenir encore plus pressants. Un des participants du groupe a des gâteaux secs qu’il commence à distribuer, mais très vite il est totalement submergé par l’afflux des mains tendues qui le tirent par sa chemise. Il trouve alors refuge dans le car.
J’ai repris ma place près de la vitre, au fond du car et là, je les observe, tous ces malheureux qui continuent de quémander en tapant dans les vitres … Bientôt je détourne la tête, j’ai du mal à supporter leurs regards, je me sens coupable. Coupable de quoi au juste ? D’être née dans un pays où l’on ne meurt plus de faim depuis longtemps ? Mais, de fait, ce n’est pas à moi de me sentir coupable, mais plutôt à ce pays lui-même qui n’est pas capable de subvenir aux besoins de sa population. Tant que la religion sera omniprésente, les choses ne risquent pas d’évoluer rapidement. On verra encore longtemps de grosses vaches bien nourries se prélasser au milieu des rues et de pauvres gens crever de faim sur les trottoirs. Comme le dit Loti :
Mon Dieu, qu’est-ce donc que ce peuple ? Et comment sont faites les âmes de ces gens, qui pour rien au monde ne tuerait un oiseau, mais qui ne se révoltent pas de ce qu’on laisse, devant leur porte, mourir les petits-enfants ?

05:32 Publié dans Livres, Pierre Loti | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, jaipur, pierre loti
mercredi, 26 novembre 2014
215. Un lieu, un livre -2-
La mer Morte et le Jourdain
Samedi 7 avril 1894
Les plans de montagnes continuent de s’abaisser vers cette étrange et unique région, située au-dessous du niveau des mers et où sommeillent des eaux qui donnent la mort. Il semble qu’on ait conscience de ce qu’il y a d’anormal en ce dénivellement, par je ne sais quoi de singulier et d’un peu vertigineux que présentent ces perspectives descendantes. [ … ]
Vers trois heures, des régions élevées où nous sommes encore, nous découvrons en avant de nous la contrée plus basse que les mers et, comme si nos yeux avaient conservé la notion des habituels niveaux, elle nous semble, en effet, n’être pas une plaine comme les autres, mais quelque chose de trop descendu, de trop enfoncé, un grand affaissement de la terre, le fond d’un vaste gouffre où la route va tomber.
Cette contrée basse a des aspects de désert, elle aussi, des traînées grises, miroitantes, comme des champs de lave ou des affleurements de sel ; en son milieu, une nappe invraisemblablement verte, qui est l’oasis de Jericho — et, vers le sud, une étendue immobile, d’un poli de miroir, d’une triste teinte d’ardoise, qui commence et qui se perd au loin sans qu’on puisse la voir finir : la mer Morte, enténébrée aujourd’hui par tous les nuages des lointains, par tout ce qui pèse là-haut de lourd et d’opaque sur la rive du Moab. [ … ]
Quand nous sommes tout en bas dans la plaine, une accablante chaleur nous surprend ; on dirait que nous avons parcouru un chemin énorme du côté du sud, er, tout simplement, nous sommes descendus de quelques centaines de mètres vers les entrailles de la terre ; c’est à leur niveau abaissé que ces environs de la mer Morte doivent leur climat d’exception. [ … ]
Dimanche 8 avril 1894
On sait que les géologues font remonter aux premiers âges du monde l’existence de la mer Morte ; ils ne contestent pas cependant qu’à l’époque de la destruction des villes maudites, elle dut subitement déborder, après quelque éruption nouvelle, pour couvrir l’emplacement de la Pentapole moabitique. Et c’est alors que fut engloutie toute cette vallée des Rois, où s’étaient assemblés, contre Chodorlahomor, les rois de Sodome, de Gomorrhe, d’Adama, de Séboïm et de Ségor (Genèse, XIV,3) ; toute cette plaine de Siddim qui paraissait un pays très agréable, arrosé de ruisseaux comme un jardin de délices ( Genèse, XIII, 10 ). Depuis ces temps lointains, cette mer s’est quelque peu reculée, sans cependant changer sensiblement de forme. Et, sous le suaire de ses eaux lourdes, inaccessibles aux plongeurs par leur densité même,dorment d’étranges ruines, des débris qui, sans doute, ne seront jamais explorés ; Sodome et Gomorrhe sont là, ensevelies dans ses profondeurs obscures …
De nos jours, la mer Morte, terminée au nord par les sables où nous cheminons, s’étend sur une longueur de 80 kilomètres, entre deux rangées de montagnes parallèles : au levant, celles du Moab, éternellement suintantes de bitume, qui se maintiennent ce matin dans des violets sombres ; à l’ouest, celles de Judée, dune autre nature, tout en calcaires blanchâtres, en ce moment éblouissantes de soleil. Des deux côtés la désolation est aussi absolue ; le même silence plane sur les mêmes apparences de mort.
Cependant, sur la sinistre grève où nous arrivons, la mort s’indique, vraiment imposante et souveraine. Il y a d’abord, comme une ligne de défense qu’il faut franchir, une ceinture de bois flottés, de branches et d’arbres dépouillés de toute écorce, presque pétrifiés dans les bains chimiques, blanchis comme des ossements, et on dirait des amas de grandes vertèbres. Puis, ce sont des cailloux roulés, comme au bord de toutes les mers ; mais pas une coquille, pas une algue, pas seulement un peu de limon verdâtre, rien d’organique, même au degré le plus inférieur ; et on n’a vu cela nulle part, une mer dont le lit est stérile comme un creuset d’alchimie ; c’est quelque chose d’anormal et de déroutant. Des poissons morts gisent ça et là, durcis comme les bois, momifiés dans le naphte et les sels ; poissons du Jourdain que le courant a entraînés ici et que les eaux maudites ont étouffés aussitôt.
Et devant nous, cette mer fuit, entre ses rives de montagnes désertes, jusqu’à l’horizon trouble, avec des airs de ne pas finir. Ses eaux blanchâtres, huileuses, portent des taches de bitume étalées en larges cernes irisés. D’ailleurs, elles brûlent, si on les boit, comme une liqueur corrosive ; si on y entre jusqu’aux genoux, on a peine à y marcher, tant elles sont pesantes ; on ne peut y plonger ni même y nager dans la position ordinaire, mais on flotte à la surface comme une bouée de liège. Jadis, l’empereur Titus y fit jeter, pour voir, des esclaves liés ensemble par des chaînes de fer, et ils ne se noyèrent point.
Du côté de l’est, dans le petit désert de ces sables où nous venons de marcher pendant deux heures, une ligne d’un beau vert d’émeraude serpente, un peu lointaine, très surprenante au milieu de ces désolations jaunâtres ou grises, et finit par aboutir à la plage funèbre : c’est le Jourdain, qui arrive entre ses deux rideaux d’arbres, dans sa verdure d’avril toute fraîche, se jeter dans la mer Morte.
Encore une heure de route, à travers les sables et les sels, pour atteindre ce fleuve aux eaux saintes.
Les montagnes de la Judée et du Moab commencent à s’enténèbrer , comme hier, sous des nuées d’apocalypse. Là-bas, tous les fonds sont noirs et le ciel est noir, au-dessus du morne étincellement de la terre. Et, en chemin, voici qu’un muletier syrien de Beyrouth — grand garçon naïf d’une quinzaine d’années que nous avons loué à Jérusalem, avec sa mule, pour porter notre bagage — se met à fondre en larmes, disant que nous l’avons emmené ici pour le perdre, nous suppliant de revenir en arrière. Il n’avait encore jamais vu les parages de la mer Morte, et il est impressionné par ces aspects inusités ou hostiles ; il est pris d’une espèce d’épouvante physique du désert ; alors, nous devons le rassurer comme un petit enfant.
Quelques ruisseaux, bruissant sur le sable et les pierres, annoncent d’abord l’approche du fleuve. Puis, subitement, l’air s’emplit de moustiques et de moucherons noirs, qui s’abattent sur nous en tourbillons aveuglants. Et, enfin, nous atteignons la ligne de fraîche et magnifique verdure qui contraste d’une façon si singulière avec les régions d’alentour : des saules, des coudriers, des tamarisques, de grands roseaux emmêlés en jungle. Entre ces feuillages, qui le voilent sous leur épais rideau, le Jourdain roule lourdement vers la mer Morte ses eaux jaunes et limoneuses ; c’est lui qui, depuis des millénaires, alimente ce réservoir empoisonné, inutile et sans issue. Il n’est plus aujourd’hui qu’un pauvre fleuve quelconque du désert ; ses bords se sont dépeuplés de leurs villes et de leurs palais ; des tristesses et des silences infinis sont descendus sur lui comme sur toute cette Palestine à l’abandon. À cette époque de l’année, quand Pâques est proche, il reçoit encore de pieuses visites ; des hordes de pèlerins, accourus surtout des pays du Nord, y viennent, conduits par des prêtres, s’y baignent en robe blanche comme les chrétiens des premiers siècles et emportent religieusement, dans leurs patries éloignées, quelques gouttes de ses eaux, ou un coquillage, un caillou de son lit. Mais après, il redevient solitaire pour de longs mois, quand la saison des pèlerinages est finie, et ne voit plus de loin en loin passer que quelques troupeaux, quelques bergers arabes moitié bandits.
Extrait de « Jérusalem » de Pierre Loti.
Septembre 2014 :
La superbe route qui nous conduit jusqu’à la mer Morte descend brutalement vers des profondeurs insoupçonnées.

À mi-chemin, nous nous arrêtons pour photographier le panneau indiquant que nous sommes exactement au niveau des mers, puis la descente continue. Lorsque nous sortons enfin du car, nous sommes saisis par une chaleur suffocante et pas le moindre souffle d’air ! Nous ressemblons à ces malheureux poissons échoués sur un rivage et qui ouvrent désespérément leur bouche. Voici bientôt les bords de la mer Morte ; il est bien loin le désert décrit par Loti. Ici ce ne sont que constructions, centres de soins, hôtels luxueux, belles résidences, magasins pour touristes.

Après le déjeuner, certains sont allés faire trempette pour tester la flottaison.
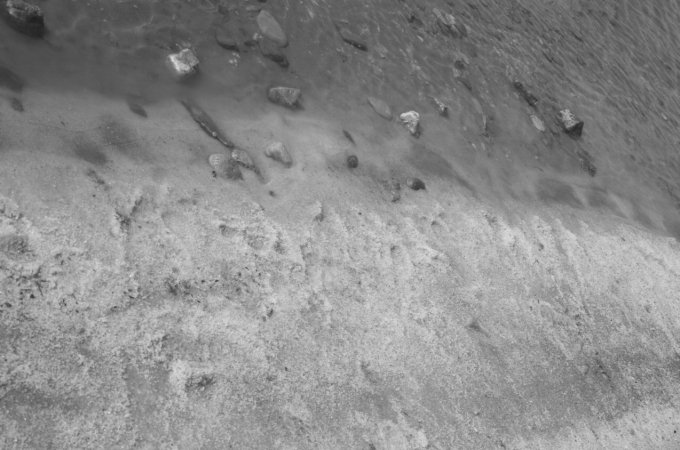
Une épaisse couche de sel s’est amoncelée sur les bords et je me contenterai d’un bain de pieds. Puis je ramasse un galet pour ma collection.

Quant au Jourdain, peut-on encore parler d’un fleuve en voyant ce minuscule filet d’eau serpenter entre les roseaux ?

L’eau n’arrive même plus à l’endroit où Jésus fut baptisé.

Mais ce qui n’a pas changé depuis le passage de Pierre Loti, c’est la visite du lieu par les pèlerins. Peut-être même sont-ils aujourd’hui plus nombreux ; une récente mosaïque nous rappelle que Jean-Paul II fut un de ces pèlerins.

07:38 Publié dans Livres, Pierre Loti | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mer morte, jourdain, jordanie, pierre loti
lundi, 17 janvier 2011
21. Made in China
Un lecteur m'a fait parvenir cette photo il y a quelques jours. Il possède un album de photos de voyage ayant appartenu à Pierre Loti et voulait savoir si je pouvais reconnaître le lieu où la photo avait été prise.
Bien évidemment ... non !

Je la trouve touchante, cette photo, datant du début du XXe siècle, avec ces enfants qui devaient être étonnés par cet homme qui les fixait ainsi pour l'éternité ! Le petit garçon a le crâne rasé. Il doit avoir dans le dos la longue queue traditionnelle.
On peut sans excès supposer que c'est Loti lui-même qui a photographié cette scène de vie, quelque part en Chine, lors de son séjour fin 1901, ou bien au printemps 1902.
16:26 Publié dans Correspondance, Photographie, Pierre Loti | Lien permanent | Commentaires (2)
dimanche, 16 janvier 2011
20. Horreur et fascination -6-

Nous sommes toujours à Bénarès en compagnie de Pierre Loti. Après la visite des rives du Gange au lever du soleil, voici maintenant une extraordinaire description des lieux au coucher du soleil :
Sur le Gange en hiver, par un soir gris. La brume des fins de jour monte du vieux fleuve sacré et ternit avant l’heure le soleil qui va s’éteindre. Bénarès, en silhouette prodigieuse de temples penchés et de palais croulants, se dresse devant l’Ouest encore lumineux […]
Et d’un bout à l’autre de cette ville, qui s’éploie sur la rive en croissant superbe, suivant la courbe de son fleuve, des escaliers en granit forment comme un immense piédestal, descendent de là-haut, de la région où les hommes ont leur demeure, vers la zone profonde et les eaux vénérées.
On les voit ce soir jusqu’aux dernières marches, les grands escaliers, jusqu’aux assises qui ne se découvrent que dans les années de malheur, et dont l’apparition signifie misère et famine. Ils sont vides, à cette heure du jour, ces escaliers majestueux où, jusqu’à midi, s’étageaient en foule les marchands de fruits, les marchands de gerbes pour les vaches sacrées, surtout les marchands de ces bouquets et de ces guirlandes que l’on jette en hommage au vieux fleuve adoré ; mais les innombrables parasols de sparterie qui abritaient tout ce monde restent là, plantés à demeure sur des hampes, et très penchés vers le levant pour le soleil du matin ; des parasols sans plissures, ressemblant à des disques de métal, et tous les granits qui servent de base à la ville en sont couverts, à perte de vue ; on dirait un champ de boucliers.
Un terne crépuscule s’annonce, et il fait subitement froid. En venant à Bénarès, je n’avais pas prévu des ciels gris et des aspects d’hiver.

Ma barque, au gré du courant, chemine en silence, rasant les bords, sous l’oppression des grandes masses sombres.
En un recoin sinistre de la berge, parmi les éboulements de palais, sur la terre noirâtre et la vase, il y a trois petits bûchers auxquels des hommes de mauvais mine, en haillons, s’efforcent de mettre le feu ; trois petits bûchers qui fument et ne veulent pas flamber ; ils sont de forme inquiétante, longs et étroits : bûchers de cadavres. Des morts y sont couchés, chacun dans le sien, les pieds vers le fleuve ; en s’approchant, on distingue, parmi les morceaux de branches, des orteils enveloppés de linge qui débordent et qui se dressent. Comme ils sont petits, ces bûchers ; il faut donc si peu de bois pour faire brûler un corps !
— Des bûchers de pauvres, m’explique un Hindou, mon batelier. Ils n’ont pas eu de quoi en acheter davantage, et c’est du mauvais bois tout humide.
Cependant l’heure de Brahma est venue et, le long du fleuve, la puissante vie religieuse du soir va commencer. Par tous les escaliers descendent les brahmes, drapés dans des voiles ; ils viennent jusqu’en bas chercher l’eau sainte, pour les ablutions et pour les rites auxquels leur caste oblige ; les marches de granit, qui étaient si désertes, se peuplent en silence ; […]

Dans le recoin des morts, près des trois bûchers fumants, il y a deux autres formes humaines empaquetées de mousseline et à demi plongées dans le fleuve, chacune reposant sur une frêle civière ; ils prennent leur bain dans l’eau sacrée, ceux-là, tout comme les vivants d’à côté, leur bain suprême, avant d’être déposés sur les piles de bois que l’on commence aussi à dresser pour eux.
Un peu au-dessus des bûchers, sur la frise d’un vieux palais qui a depuis longtemps roulé au fleuve, des gens, cinq ou six au plus, se tiennent accroupis, la tête enveloppée d’un voile, et semblent regarder avec attention comme le fakir : les parents de ceux que l’on brûle.
Maintenant, au sommet des gigantesques escaliers, une recrue nouvelle pour les bûchers fait son apparition ; un cinquième cadavre débouche là-haut d’un couloir d’ombre qui est une rue, et s’achemine vers le vieux Gange, où sa cendre sera jetée. Sur des branches de bambou liées en brancard, six hommes de basse caste, dépenaillés et demi-nus, l’amènent les pieds en avant, presque debout, tant la pente est raide ; personne ne suit, personne ne pleure, et des enfants, qui descendent aussi pour se baigner, comme s’ils ne voyaient rien, sautent gaiement alentour […]
Une mousseline rose, à grands dessins éclatants, enveloppe ce cadavre qui arrive, et des fleurs blanches de gardénias, des fleurs rouges d’hibiscus sont attachées à ses reins. C’est une forme de femme ; ces fleurs, du reste, suffisaient à le faire prévoir ; mais l’étoffe légère la révèle admirable, malgré l’affaissement glacé. « Une fille de riches, me dit le batelier, voyez le beau bois qu’on lui apporte. »
Il est bientôt l’heure du coucher des oiseaux qui, aux Indes et surtout à Bénarès, prend toujours tant d’importance ; des nuées de corbeaux, criant la mort, des nuées de pigeons vont et viennent dans le ciel pâle, et chaque pyramide de temple a son tourbillon spécial, qui évolue en cercle alentour, à la manière des pierres de fronde. La brume du fleuve, qui s’épaissit toujours, est de plus en plus froide, et l’odeur des décompositions traîne plus lourdement dans l’air du soir […]

Et je reviens vers les bûchers… C’est le vrai crépuscule à présent, et les oiseaux ont fini de tournoyer dans l’air ; sur toutes les corniches de temples ou de palais, ils se sont posés en rang pour la nuit et forment de longs cordons qui frémissent encore, agités de derniers battements d’ailes […]
J’arrive trop tard au recoin des morts. Un grand bûcher flambe, un bûcher de riche, d’où s’échappent des étincelles et des flammes en tourmente ; elle est au milieu, la jeune fille, et on ne voit plus rien d’elle, rien qu’un lugubre pied, un seul, qui a les doigts écartés étrangement comme par un excès de souffrance et qui se découpe en silhouette noire devant la lueur du feu.
Cependant, de ces deux formes humaines prostrées sous des voiles de pauvre, qui regardaient impassiblement brûler le tout petit mort du haut d’une pierre de frise, l’une se lève, se penche au-dessus de lui, se découvre le visage, pour voir de plus près et mieux. Et la lueur du bucher de la jeune fille éclaire en plein ses traits : une vieille femme décharnée.
« Est-il bien tout brûlé, au moins ? » semble-t-elle dire. Elle est très vieille, c’est quelque grand-mère, plutôt que la mère […] Ses pauvres yeux expriment l’inquiétude de n’avoir pas eu assez d’argent pour lui acheter le bois qu’il aurait fallu, la crainte que les impitoyables brûleurs n’aillent jeter à l’eau des fragments encore reconnaissables. Elle se penche à nouveau, regarde anxieusement, à la lueur du bûcher des riches, tandis que le brûleur, pour lui montrer qu’il n’y a plus rien, remue avec une branche les restes des tisons noirs qui sont par terre. Alors elle fait un signe :
« Oui, c’est bien ; allez, vous pouvez jeter au fleuve. »
Avec une pelle en bois on jette au fleuve les derniers tisons noircis, les restes du bûcher de misère.
Et, sur le bûcher voisin, le pied de la belle jeune fille, le pied aux doigts écartés tombe enfin dans les cendres.» 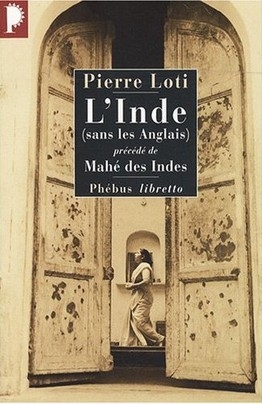
Voilà, je m’arrête ici dans la transcription du texte. Vous pouvez toujours retrouver l’intégralité du récit dans le livre de Pierre Loti : « L’Inde (sans les Anglais) »
Je ne vous cacherai pas que j’appréhende un peu cette visite qui sera en fin de voyage. J’aurai l’occasion de vous en reparler à mon retour.
16:43 Publié dans Pierre Loti, Voyages | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 13 janvier 2011
19. Horreur et fascination -5-
Si vous prenez le temps de lire mes notes, vous avez dû vous apercevoir que le circuit de mon prochain voyage est légèrement modifié. J’ai réussi à trouver un voyage qui inclut la visite de Bénarès (Vârânasi). Comme je n’aurai probablement jamais l’occasion de retourner dans cette partie du monde, je ne pouvais manquer cette visite.
Pour mieux découvrir cette ville, j’ai donc replongé dans la lecture des « Récits de voyage » de Pierre Loti.
Loti décrit ce qu’il voit de manière si fabuleuse qu’on a l’impression d’y être, de voir les scènes et presque de sentir les odeurs.
Pour ceux qui viennent ici — c'est-à-dire sur mon blog — pour seulement trente secondes, passez votre chemin ! Il n’y a rien à voir, juste faire l’effort de lire …
Pour les autres, je prends le temps de recopier (j’allais dire bêtement, mais non, en fait cela me permet de m’imprégner des mots) de larges extraits de ce merveilleux récit en Inde.
Pour tâcher de rendre l’atmosphère, j’ai mis de la musique qui me semble en accord avec les lieux.
Partons donc à la découverte de cette ville si mystérieuse pour nous, Occidentaux. Je n’ai pas suivi l’ordre du livre, mais plutôt l’ordre du temps qui s’écoule. C’est donc au matin que nous allons nous retrouver sur les bords du Gange. Pierre Loti intitule ce chapitre La gloire du matin :

« Du fond de la plaine où coule le vieux Gange, du fond de l’immense plaine de vase et d’herbages que les vapeurs de la nuit embrument encore, l’éternel soleil vient de surgir et, ainsi que tous les jours depuis trois mille ans, il rencontre là devant lui, arrêtant son premier rayon rose, les granits de Bénarès, les pyramides rouges, les pointes d’or, toute la ville sainte dressée en amphithéâtre, comme pour saisir avidement la lumière initiale, se parer de la gloire du matin. Et ici, c’est l’heure par excellence ; c’est, depuis le commencement des âges brahmaniques, l’heure consacrée, l’heure de la grande vie religieuse et de la grande prière. Bénarès soudainement déverse sur son fleuve tout son peuple, toutes ses fleurs, toutes ses guirlandes, tous ses oiseaux, toutes ses bêtes. Par les escaliers de granit, à cette apparition du soleil, c’est un joyeux écoulement de tout ce qui vient de s’éveiller, de tout ce qui a reçu de Brahma une âme, humaine ou obscure. Les hommes descendent, l’air heureux et grave, drapés dans des cachemires roses, ou jaunes, ou couleur d’aurore. Les femmes, en blanches théories, descendent voilées à l’antique sous des mousselines. Elles apportent des aiguières, des buires (vases à col étroit), qui mettent partout l’éclat rouge ou jaune des cuivres fourbis, à côté de l’étincellement de leurs mille bracelets, colliers, ou anneaux d’argent autour des chevilles. Noblement belles d’allure et de visage, elles marchent comme des déesses, et on entend sonner, à leurs bras, à leurs jambes, les cercles de métal.

Et chacun veut offrir au fleuve des guirlandes, des guirlandes, comme s’il ne suffisait pas de toutes celles des jours précédents qui flottent encore […] Là-haut, tous les miradors ajourés, toutes les fenêtres à festons et à colonnettes, toutes les terrasses qui voient le levant, se garnissent de têtes de vieillards ; spectateurs empêchés de descendre, par la maladie ou les années, mais qui veulent leur part de lumière matinale et de prière. Et le soleil les inonde de chauds rayons […]
Sur les radeaux innombrables et sur les marches d’en bas, le peuple de Brahma, déposant ses guirlandes et ses aiguières, commence de se dévêtir. Les draperies blanches ou roses, les cachemires de toutes nuances sont jetés çà et là, ou tendus sur des bambous, et alors des nudités apparaissent, couleur de bronze sombre ou de bronze pâle. Les hommes, à la fois sveltes et athlétiques, avec des yeux de flamme, entrent jusqu’à la taille dans l’eau sainte. Les femmes, moins dévoilées, gardant une mousseline sur la gorge et les reins, trempent seulement dans le Gange leurs jambes, leurs beaux bras cerclés d’anneaux, et puis elles s’agenouillent et se penchent sur le bord extrême, pour lancer plusieurs fois dans le fleuve leur longue chevelure dénouée ; l’eau qui ruisselle alors sur leur poitrine, sur leurs épaules, fait plaquer la fine étoffe révélatrice, et elles ressemblent à la « Victoire aptère », plus belles et plus troublantes que si elles étaient nues.

Pour remonter dans leurs demeures, les femmes reforment leurs théories blanches ou multicolores qui, cheminant le long des marches, tout contre les larges pierres, rappellent les bas-reliefs de la Grèce antique.
Les hommes, tous restés sur le Gange, et assis maintenant dans la pose hiératique, achèvent, avant de s’immobiliser en extase, leur toilette religieuse ; sur le bronze lavé de leur torse, ils tracent en l’honneur de Siva des raies de cendre, et sur leur front, avec du carmin, le sceau terrible […]
Au ras de l’eau, un qui prie, les yeux blancs, assis sur une peau de gazelle, garde avec une fixité à faire peur la pose des statues de Çakya-Mouni, qui est aussi par excellence la pose fakirique : accroupi les jambes croisées, les genoux touchant le sol, et la main gauche — une longue main osseuse — tenant le pied droit. C’est un vieillard, et la couleur de sa robe, qui plaque toute ruisselante sur son corps décharné, indique un saint yoghi : elle est d’un rose orangé très pâle, cette robe, comme les nuages d’aurore. Il prie immobile, le sceau de Siva fraîchement inscrit sur son front, les prunelles vitreuses, la face livide tournée en plein soleil, en plein soleil étincelant, avec une expression de béatitude infinie. Un jeune athlète nu, préposé à sa garde, de temps à autre prend de l’eau du Gange pour inonder la robe couleur d’aurore, ou pour asperger toutes les guirlandes posées devant le vénérable ascète, sur la peau de gazelle dont la tête et les cornes trempent dans le fleuve.
Afin de bercer mieux son rêve sans doute, on lui joue aussi une petite musique sacrée ; il y a pour cela deux garçons, qui sourient gaiement, penchés au-dessus de lui sur les granits éboulés ; l’un souffle dans une conque marine, qui fait : hou ! hou ! d’un timbre plaintif de cor lointain ; l’autre frappe doucement sur un petit tam-tam de sonorité voilée. Des corbeaux, çà et là perchés alentour, l’observent avec attention. Et tous ceux qui remontent vers leur demeure, femmes ou enfants, se détournent de leur chemin pour venir le saluer avec respect : rien qu’un sourire de joyeux bonjour, avec une révérence les mains jointes, et on s’en va discrètement, comme par crainte de détourner son attention, de troubler sa prière.
Ma barque revient une heure plus tard, après avoir remonté le courant jusqu’au quartier des palais mystérieux. Et, à mon retour, il est encore là, le vieillard, tenant son pied maigre dans sa main aux longs doigts ; son regard même n’a pas bougé, et le soleil plus brûlant ne semble pas éblouir ses yeux ternes, levés béatement vers le ciel.
— Comme il est tranquille ! dis-je …
Le batelier me regarde, me sourit comme on ferait à un enfant dont la réflexion serait trop naïve :
— Celui-là ?... Mais… il est mort !
Ah ! il est mort !... En effet, je n’avais pas remarqué une lanière de cuir, qui passe sous le menton pour retenir la tête contre un coussin. Je n’avais pas remarqué non plus un corbeau qui s’obstine à tourner autour et tout près du visage ; le jeune athlète, chargé de jeter de l’eau sur sa robe jaune rose et sur les guirlandes de jasmin, est obligé à toute minute de l’effrayer, avec une draperie qu’il agite.
Il est mort depuis hier au soir, et, après l’avoir baigné, on l’a pieusement assis là, en pleine gloire du matin, dans la pose de prière qui fut la pose de toute sa vie. Et, en attachant sa tête, on l’a un peu renversé en arrière, pour qu’il pût mieux voir le soleil et le ciel.
Il ne sera pas point brûlé, car on ne brûle pas les yoghis, la sainteté de leurs actes ayant purifié suffisamment la matière de leur corps ; ce soir, on l’ensevelira tel quel dans un vase de terre qui sera descendu au fond du Gange. Et ce sont des saluts de félicitation, des compliments de fête, que chacun, avec une figure joyeuse, vient lui adresser, à ce bienheureux qui, par ses mérites et son détachement de ce monde, est sans doute affranchi à jamais du cycle des réincarnations, délivré de l’abîme de la vie et de la mort.
Un chien s’approche, le flaire et s’en va la queue basse. Trois oiseaux rouges s’approchent aussi et le regardent. Un singe descend, touche le bas de sa robe mouillée, puis remonte en courant jusqu’au sommet des escaliers. Et le jeune gardien les laisse faire, ne chassant avec impatience — une impatience inusitée en ce pays où l’on supporte tout de la part des bêtes — que le corbeau entêté, qui a senti la décomposition et qui revient toujours, frôlant presque de son aile noire le visage du bienheureux, extasié dans la mort.»

Cette description laisse sans voix. Quel monde étrange pour nous, Occidentaux, tellement obnubilés par tout ce qui est du domaine matériel, de notre confort personnel.
À suivre
19:20 Publié dans Pierre Loti, Voyages | Lien permanent | Commentaires (0)



